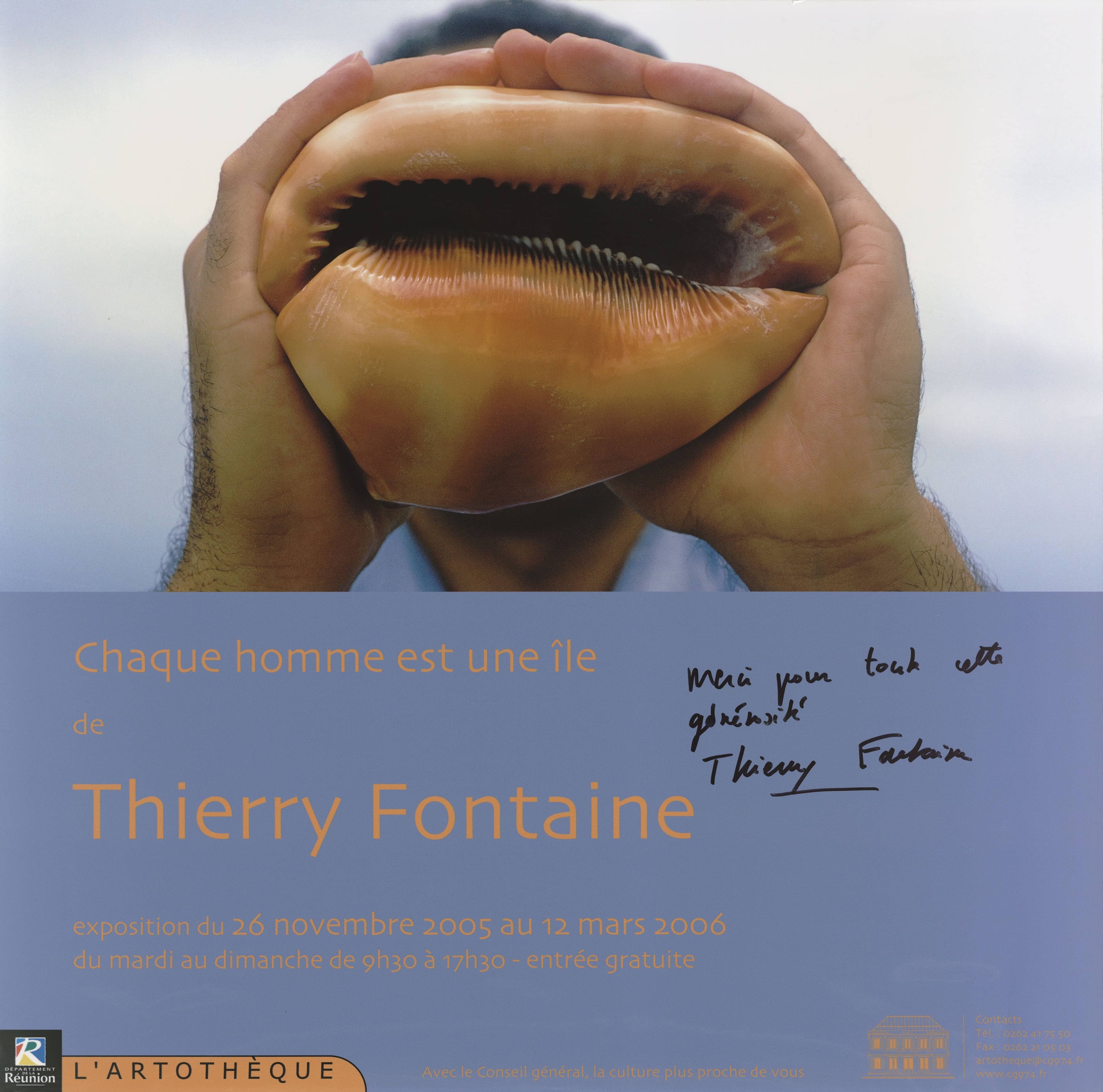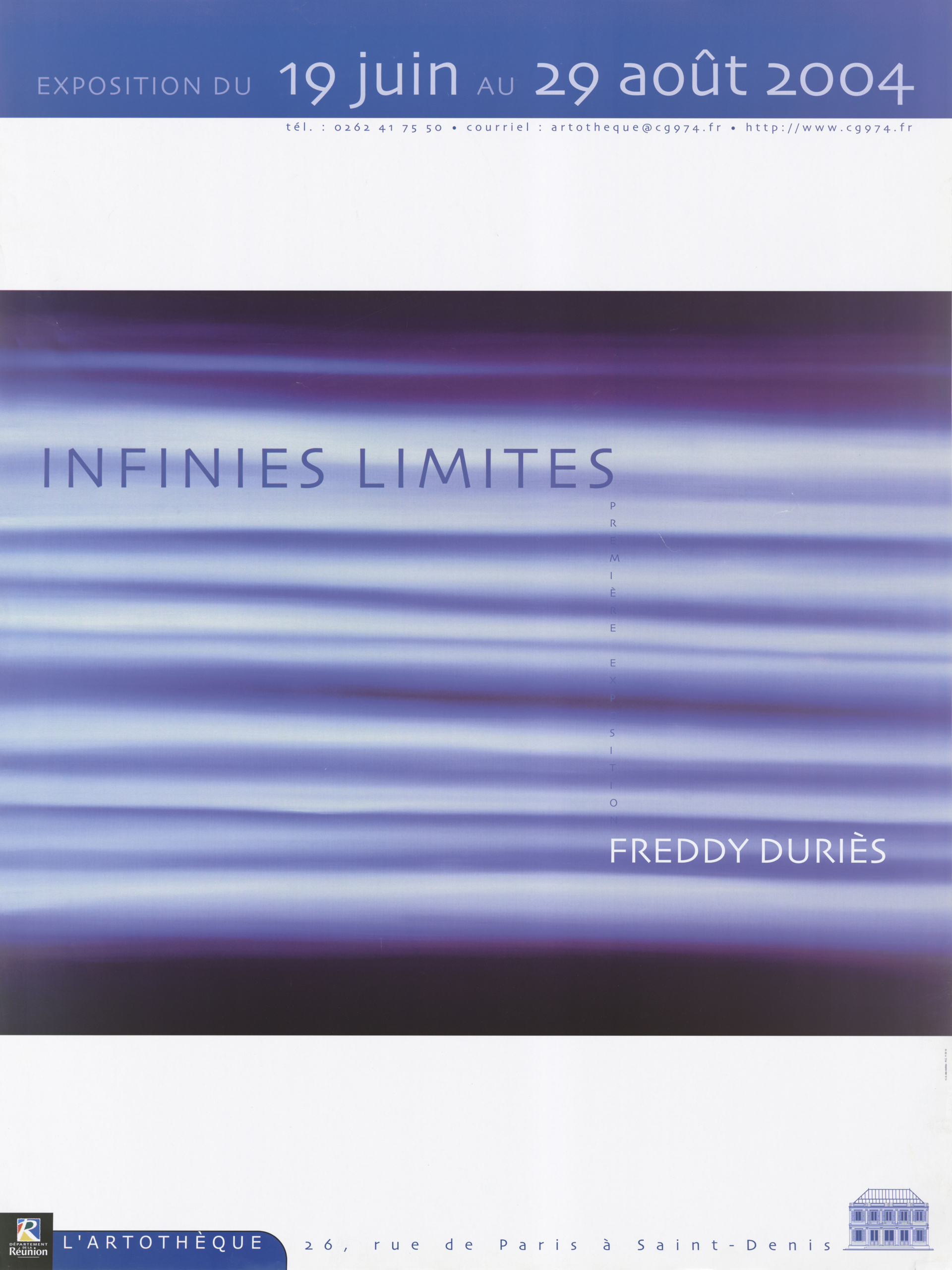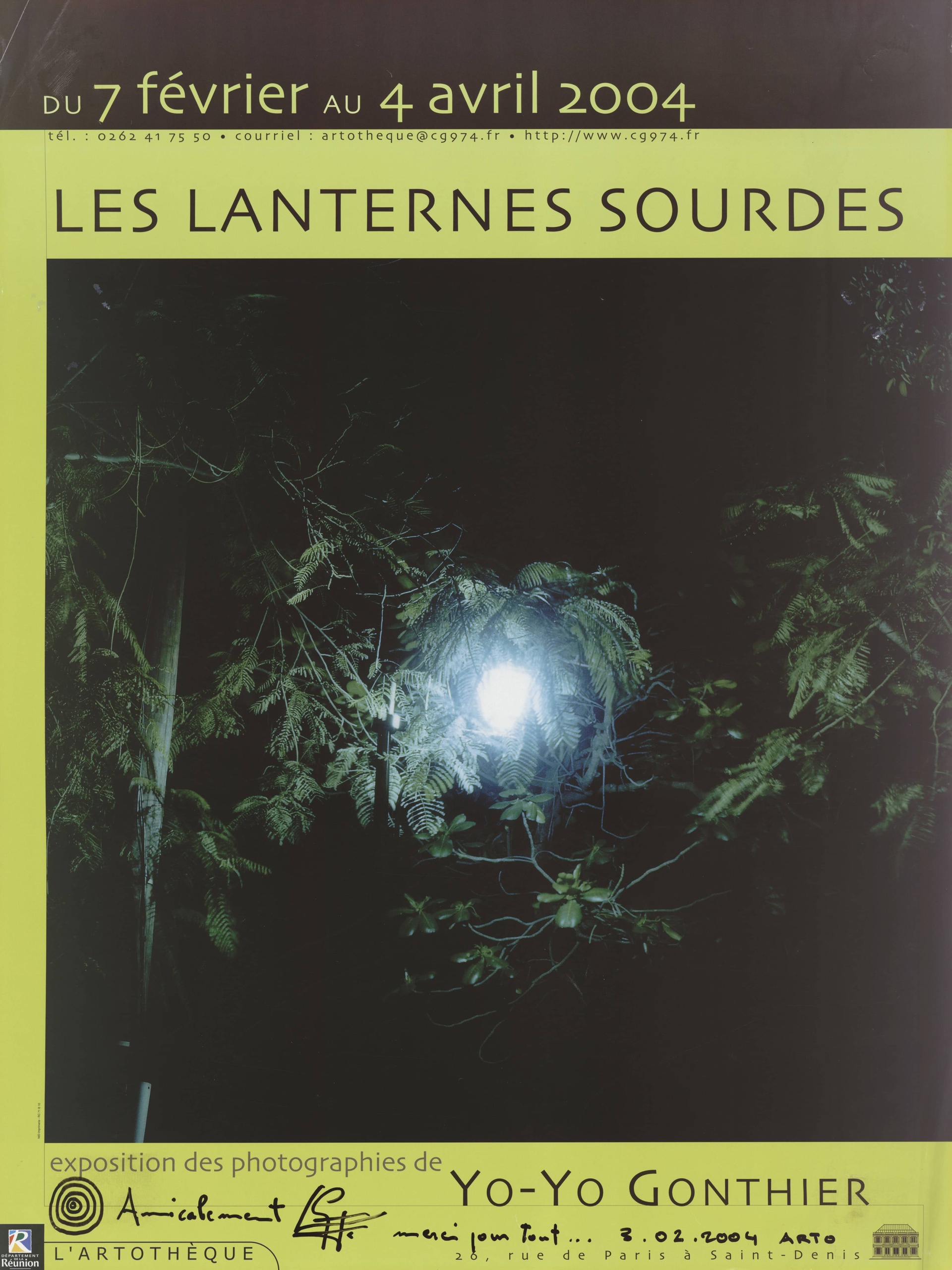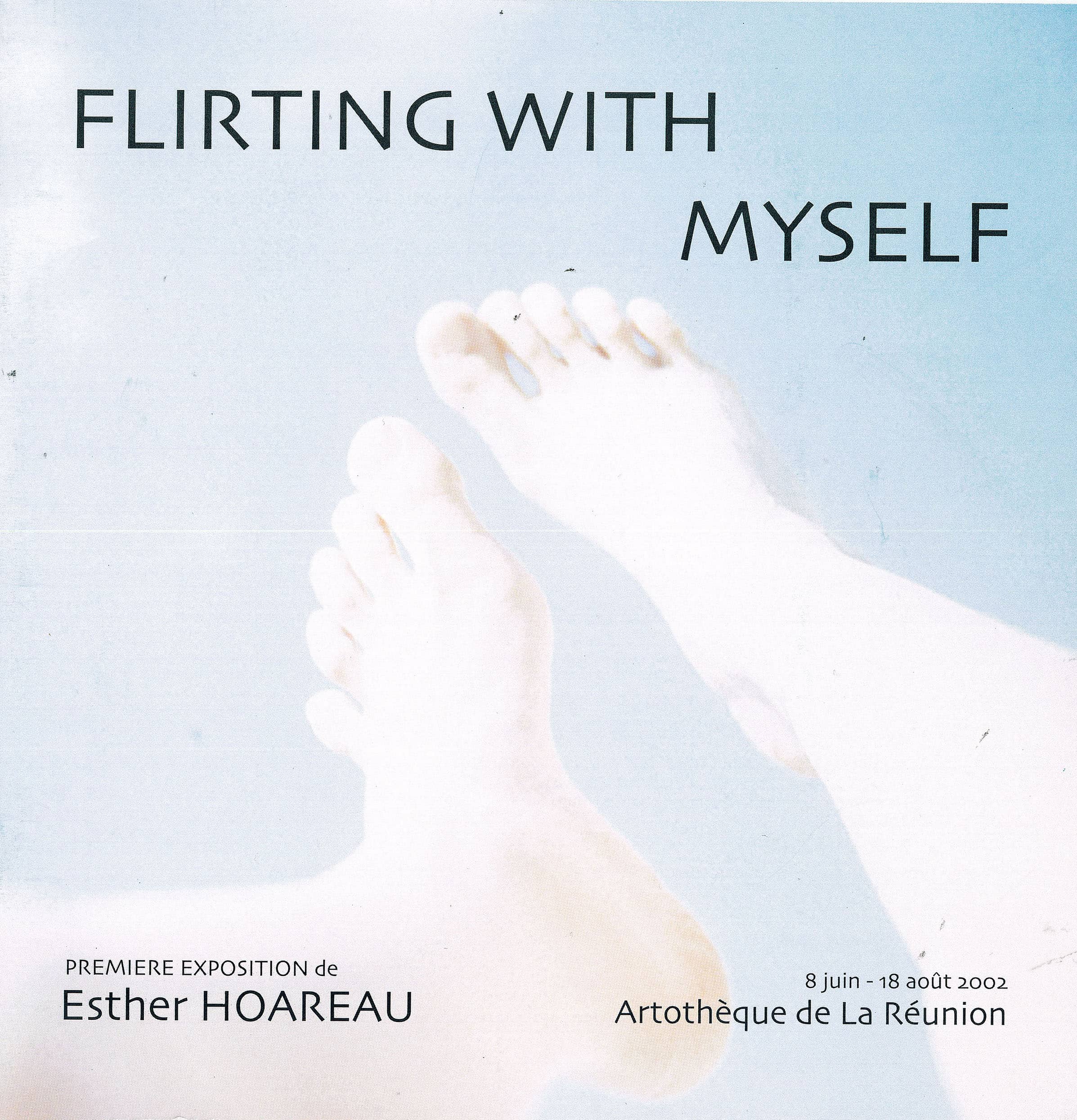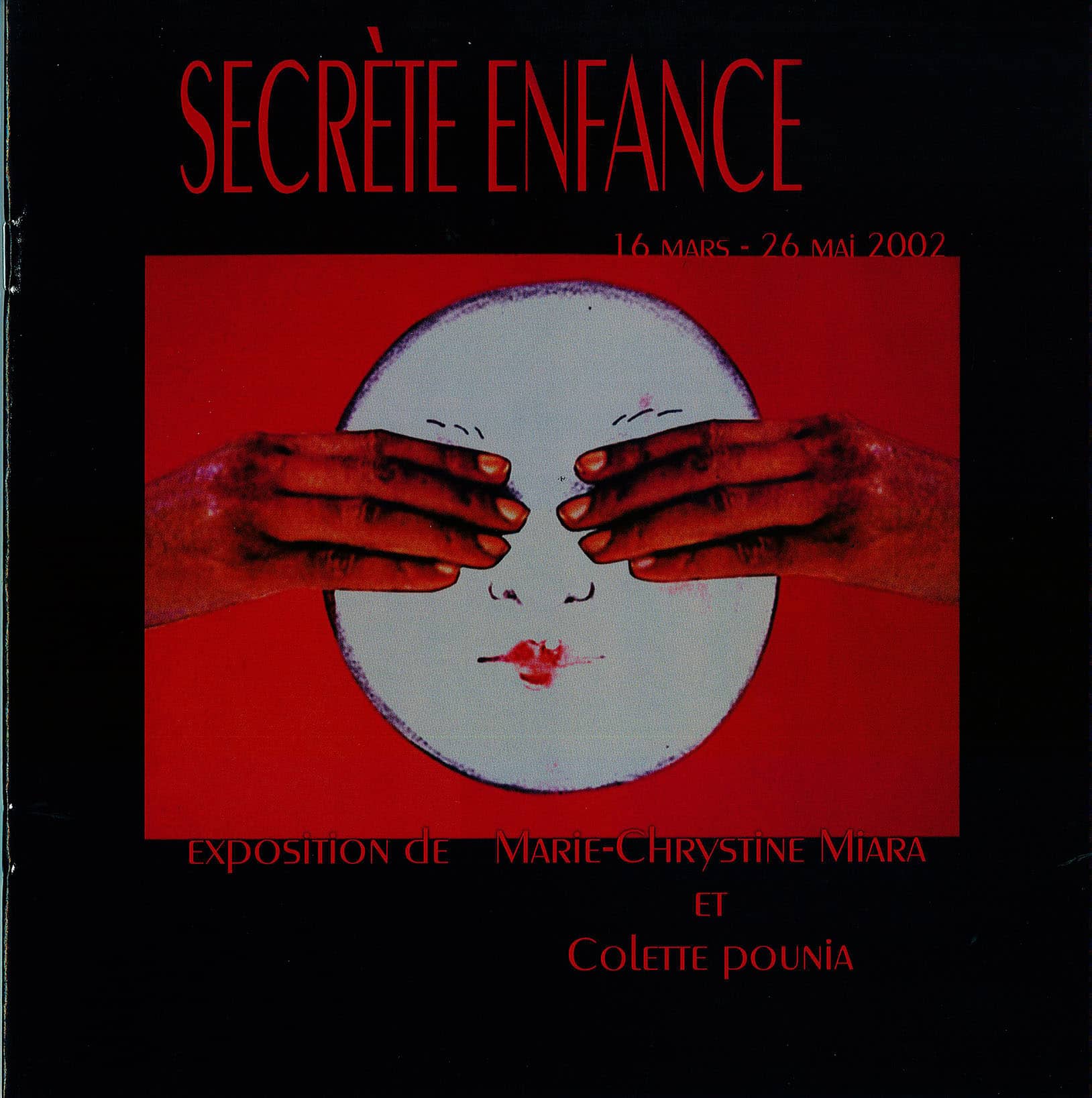Figure médiatisée, le Dalaï-Lama, chef spirituel du peuple tibétain, apparaît comme le représentant de toutes les formes du bouddhisme aux yeux des Occidentaux. Ce n’est pas à un pays, ni à sa population, non plus à un représentant religieux, que le prix Nobel de la Paix a été décerné en 1989, mais à un « modèle » d’un genre nouveau qui a su mettre en relation spiritualité, mouvement de libération national, défense des droits de l’homme, un rapport différent à la nature et une religion d’une grande tolérance, qui fait dire au Dalaï-Lama : « Ne devenez pas bouddhisme, découvrez ce que vous êtes ». Le caractère moderne de son message aux valeurs universelles de paix, d’environnement (le respect de tous les êtres vivants), de solidarité (de compassion), favorise l’appropriation du bouddhisme par les sociétés occidentales, qui y voient à la fois une sagesse philosophique et une voie spirituelle.
Rennie Pecqueux-Barboni appartient à cette génération d’hommes de la fin du vingtième siècle qui ont trouvé dans le bouddhisme prônant une « révolution intérieure », la réponse aux idéologies disparues de nos sociétés occidentales.
« Vers Les Jardins de la Terre Pure », est l’itinéraire d’une ballade intérieure à travers le bouddhisme, les figures qui l’ont marqué dans cette religion devenue sienne, et en faveur de laquelle il a été ordonné moine dans l’école Zen.
« La légende dorée » :
C’est en Inde, au début de notre ère, que Nagarjuna donnera sa plus brillante expression au Mahayana, le bouddhisme du Grand Véhicule – celui qui s’épanouira dans les pays asiatiques- à travers l’école de la voie moyenne, Madhyamika. Celle – ci enseigne la théorie de la vacuité universelle. Aussi éloignée du réalisme que du nihilisme absolu, elle se situe au milieu. Ce grand penseur donnera une plus précise interprétation de l’enseignement du Bouddha en démontrant le caractère illusoire de toute chose, de l’existence mais aussi de son contraire, l’inexistence.
Peu d’informations nous sont parvenues sur la personnalité de ce philosophe mais la légende rapporte qu’après avoir médité et écrit de nombreux traités, il se retira pour coudre des toges de moine.
C’est ainsi que l’artiste le représente, évoluant vers l’état d’éveillé sur une longue « fresque » ponctuée des mêmes mains qui, avec la même gestuelle, la même précision, ont écrit des sûtras et cousu les vêtements monastiques.
Avec le légendaire Boddhidharma, c’est la pratique de la méditation et le rituel du thé qui entre en Chine à travers l’école du Chan (zen en japonais). Venu de son Inde natale, il demeura neuf ans assis en lotus et, pour lutter contre le sommeil, s’arracha les paupières. A l’endroit où elles tombèrent, un arbuste poussa. Intrigué, L’Empereur vint un jour lui rendre visite. Quelques feuilles tombèrent dans sa tasse donnant ainsi naissance à la Cérémonie du Thé.
Toutefois, le véritable instaurateur du Chan en Chine du Sud fut Houei-Neng, (638-713) qui, souvent présenté comme un illettré fougueux, en réaction contre l’opulence monastique de la capitale, étudia cependant, prêcha et rédigea un sûtra de l’Estrade. Sa momie sourit, de nos jours encore, dans un monastère des environs de Canton.
Pure création du bouddhisme chinois, le Chan emprunte la voie moyenne de Nagarjuna et la philosophie taoïste pour enseigner « l’Eveil subit ». La nature de Bouddha étant innée, la seule prise de conscience suffit à mener vers la réalisation de soi.
Les Pèlerinages de Rennie Pecqueux-Barboni nous disent la nécessité d’une prise de conscience de cette lumière qui est en nous, par l’introspection, la méditation.
Le Chan et la Terre Pure forment les deux grandes « écoles » du bouddhisme en Chine et au Japon. La Terre Pure c’est le Paradis du Bouddha Amita où sont admis tous ceux qui pratiquent la dévotion souvent réduite à la seule évocation du nom d’Amitabha. Voie de Salut « facile » où seule une foi entière confiée à la grâce du Bouddha suffit, le Paradis d’Amitabha permet au plus grand nombre, sans autre effort personnel ou exercices psycho-physiques, d’y être admis.
L’analogie avec « l’Eveil subit » du Chan devient ainsi évidente et explique que la dévotion en Amitabha se maintienne en association avec le Chan, le Zen.
La représentation du Paradis d’Amitabha, région de pureté, a donné lieu à d’excellentes œuvres artistiques où l’imaginaire et le fantastique trouvent leur pleine expression.
Rennie Pecqueux-Barboni a choisi, quant à lui, d’évoquer les Jardins d’Amitabha sous la forme de l’une des portes d’un mandala, cosmogramme illustrant la structure de l’univers et dont la visualisation permet de gagner la maîtrise de l’esprit.
Il s’agit bien sûr de la porte de l’Ouest qui correspond à la Terre Pure.
San sui (paysage en japonais), est l’occasion d’associer des peintures abstraites de couleurs chatoyantes aux compositions plus rigoureuses d’un Kesa (toge de moine), brodé aux motifs de paysages et d’un Kare-sansui (paysage sec en japonais).
Issu du bouddhisme Chan et inspiré par la peinture chinoise de paysage, le jardin de pierres et de sable, le Kare-sansui japonais, par sa grande sobriété, est avant tout destiné à la contemplation. L’immense simplicité, la beauté des espaces vides et le contraste de la ligne droite et des formes naturelles, sa propre nature. Il est l’image de l’esprit pacifié.
Instruit par les Maîtres, guidé par la lumière, purifié par le travail sur soi, le disciple peut parvenir au « Saint des Saints » et découvrir le joyau qui est en lui pour enfin parvenir à la libération éternelle. Véritable trésor, Le retable de l’Octuple Sentier de Rennie Pecqueux Barboni nous ouvre les huit portes qui y conduisent : la maîtrise de la lucidité, de la compréhension, de la parole, de l’action, des moyens, des efforts, la concentration et la méditation.
« La matière dans tous ses états » :
L’histoire du bouddhisme Mahayaniste à travers ses personnages illustres et les moyens d’accéder au Salut nous est racontée par l’artiste à la manière des premiers Jâtakas, récits de la vie du Bouddha, avec ce côté enfantin et surtout ce même souci didactique qui préside à la conception des dessins davantage conçus comme une écriture.
Ce qui importe avant tout c’est cette attention minutieuse au travail d’assemblage, de montage, de collage, de couture et de broderie, de couleurs toujours lumineuses, la richesse des matériaux, la somptuosité de la soie, des bois d’ébénisterie, qui sont un véritable éloge de la matière. L’univers entier y est contenu, tous les éléments y sont présents.
Tout ici défie le regard ; là une céramique, beau morceau de nature morte peinte en trompe-l’œil, puis un assemblage de tessons de porcelaine chinoise. Le bois précieux est-il collé ou peint ? Dans cette magnifique étoffe il est bien difficile de savoir où commence la peinture et où s’insère le tissu véritable. Même la perspective, tantôt feinte, tantôt réelle, se joue de nos sens. La fiabilité de notre perception se perd dans la contemplation des miroirs, elle est modifiée par la présence des fenêtres qui fixent un « point de vue » et orientent le regard. Une sorte de jeu magique s’installe, qui nous conduit inévitablement à nous interroger sur le caractère illusoire de toute chose.
Les démarches plastiques de l’artiste se conjuguent avec sa recherche spirituelle. Art religieux, certes, mais aussi au cœur des problématiques contemporaines. Il dénonce les illusions de la représentation tout en « recollant » les morceaux du Tout dans cette recherche d’éternité par une union avec le Cosmos.
Quelques minutes après le Big-bang, l’univers tout entier, avec ses galaxies, ses étoiles, le feu, le métal, l’eau et l’air que nous respirons, était contenu dans un volume équivalent à une orange, nous disent les scientifiques. La réalisation de cette ré-union recherchée par les bouddhistes demande de s’affranchir des illusions sur nos individualités, qui ne sont qu’un assemblage de phénomènes : sensations, perceptions, conceptions… tous aussi fugaces, impermanents et inconsistants
« L’Orient intérieur » :
L’universalité de la pensée jointe à la cohérence des techniques utilisées par l’artiste œuvrent en faveur de l’objectif du religieux qui est de favoriser la contemplation, occasion d’illumination.
Contemplation et visualisation étant des méthodes indispensables au bouddhisme Mahayaniste, la richesse des couleurs, les matériaux précieux, l’aspect somptueux, le raffinement et la précision du geste participent de cette volonté de mettre au service d’une énergie spirituelle toute satisfaction esthétique et émotionnelle.
De même le recours au langage des symboles révèle la nécessité d’atteindre les profondeurs de la conscience, inaccessibles par la pensée conceptuelle.
Universel, mais très présent dans le bouddhisme, le mythe du paradis terrestre enfoui en chacun et qu’il est nécessaire de retrouver pour atteindre la lumière est une allégorie du chemin initiatique sur lequel sincérité, force et foi sont testées à chaque épreuve avant de conduire à l’éveil.
Enfin, le trésor, symbole puissant d’une richesse intérieure et dont la découverte passe souvent par une incursion dans un univers spirituel étranger au sien, se trouve également illustré par cette fabuleuse histoire d’un personnage qui parcourt le monde à la recherche d’un trésor vu en rêve, pour ne rencontrer qu’un autre homme ayant lui aussi fait ce curieux songe et désignant l’emplacement de son « eldorado » comme étant le lieu d’origine du voyageur. Ce dernier rebrousse chemin et, de retour chez lui, trouve enfin la fortune rêvée.
De nombreuses variantes de cette histoire existent, qui témoignent toutes de ce mystère de la rencontre. Le vrai trésor est tout proche, en nous-mêmes, mais c’est chaque fois un étranger, d’une autre race ou d’une autre religion, qui sert de révélateur à notre être profond.
Ainsi, Rennie Pecqueux-Barboni, français d’origine corse, a-t-il choisi de parcourir les sentiers de la sagesse extrême-orientale pour trouver son trésor intérieur et nous invite à partager son cheminement.
Caroline de Fondaumière
Historienne de l’Art